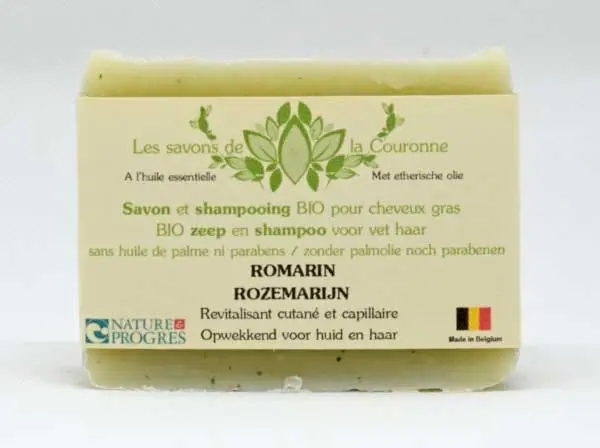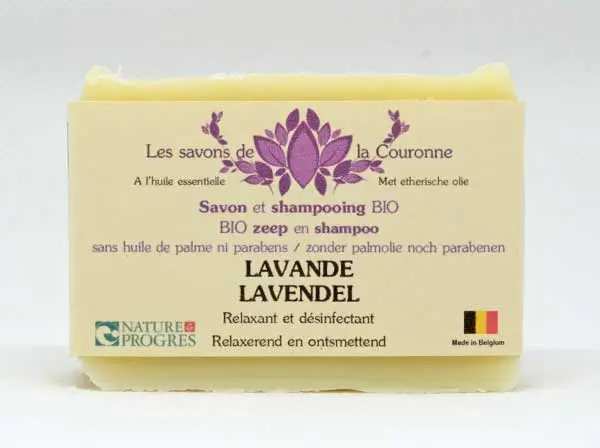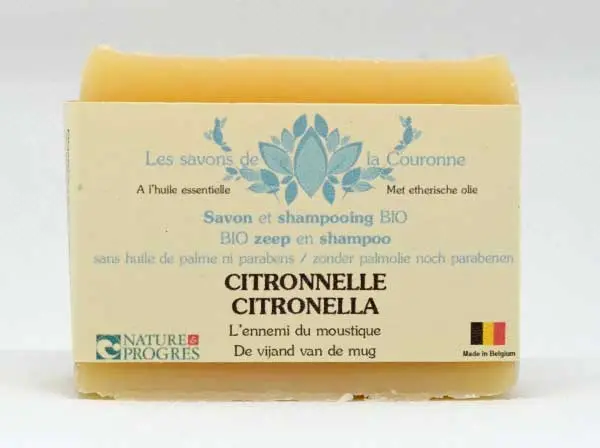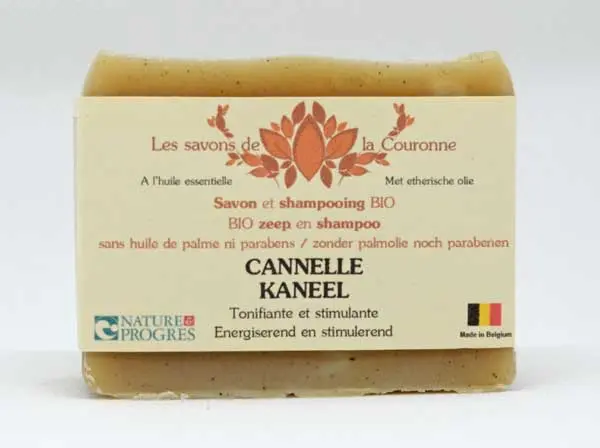Plongée historique et chimique dans la peau d’un ingrédient mal compris
Introduction
Rien que son nom déclenche la crispation : soude caustique.
Deux mots qui évoquent des brûlures, des précautions de laboratoire, voire des produits toxiques interdits de contact. Et pourtant… dans l’univers du savon saponifié à froid, cette molécule est l’actrice principale de la transformation. Sans elle, aucun savon ne pourrait exister.
Cet article propose une revue complète de ce qu’est la soude : son rôle réel, ses origines historiques, sa réputation ambivalente, et la manière dont elle a été diabolisée — souvent par ignorance, parfois par stratégie marketing.

Soude : l’ingrédient qu’on préfère cacher
Pour beaucoup, le savon “naturel” évoque des plantes, des huiles, des parfums doux… mais rarement de la chimie. Et surtout pas un nom aussi tranchant qu’hydroxyde de sodium.
La réalité est pourtant simple : le savon est un produit chimique. Mais pas au sens industriel du terme. C’est une réaction organique naturelle, appelée saponification, au cours de laquelle un corps gras (huiles ou beurres végétaux) réagit avec une base forte (la soude).
Ce processus :
- transforme totalement la soude,
- neutralise sa causticité,
- crée du savon et de la glycérine.
La soude n’est pas un ingrédient du savon fini. C’est un agent de transformation. Elle est consommée intégralement par la réaction chimique.
Une réaction millénaire, souvent empirique
Les premières traces de saponification remontent à plus de 3 000 ans. Les Sumériens utilisaient déjà un mélange de graisses animales et de cendres végétales pour fabriquer une pâte lavante. À l’époque, ils ne comprenaient pas la réaction, mais en observaient les effets.
Les Égyptiens, les Grecs puis les Romains ont perfectionné les techniques, en utilisant différentes plantes riches en carbonates (comme la salicorne) et des graisses variées. C’est au 7e siècle, dans le monde arabe, que la chimie du savon progresse réellement, avec les bases du mot “alcali” (du mot arabe al-qaly, désignant les cendres riches en sels).

Salicorne © 2006 by FortBienVert is licensed under CC BY-SA 2.0
Mais la véritable industrialisation de la soude arrive au XVIIIe siècle, avec Nicolas Leblanc, chimiste français qui met au point un procédé de fabrication à grande échelle à partir de sel de mer. Ce processus, bien qu’efficace, provoque une pollution importante à cause de ses sous-produits toxiques, notamment le sulfure d’hydrogène.
De la révolution industrielle au savon domestique
À partir du XIXe siècle, la production de soude devient un enjeu industriel majeur. Le savon, autrefois réservé aux riches ou aux prêtres, entre dans les foyers bourgeois, puis populaires.
C’est aussi l’époque où la chimie prend une place dominante dans l’économie. La soude, désormais produite en masse, devient un ingrédient de base dans de nombreuses industries : verrerie, textile, papier… et bien sûr, hygiène.
Mais cette popularité s’accompagne de méfiance :
- La soude est corrosive ;
- mal manipulée, elle peut causer des brûlures graves ;
- elle est utilisée dans des produits dégraissants agressifs.
Ce contraste entre sa puissance chimique et son utilisation quotidienne nourrit une forme de suspicion durable.
L’ennemie rêvée des campagnes marketing
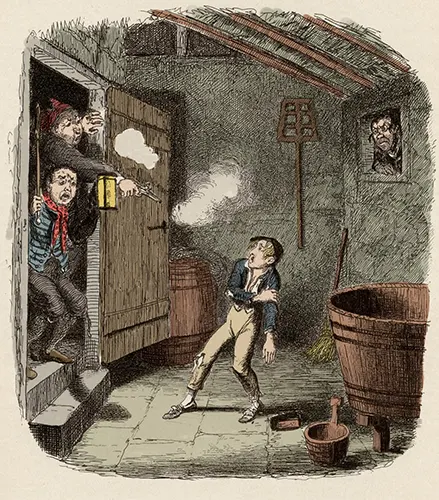
Dans les années 2000, dans le même élan qui voit l’intérêt pour le bio se développer, son double maléfique entre en jeu : le greenwashing. De nombreuses marques surfent sur la peur de la chimie. La soude devient alors une cible facile pour les slogans simplistes comme :
- “Sans soude” ou
- “Sans ingrédients chimiques”
Ces formules, bien que séduisantes, relèvent souvent de la désinformation, car, répétons-le : sans soude, pas de savon.
Ce que ces marques proposent, ce sont des syndets (détergents synthétiques solides) qui n’ont rien à voir avec le savon traditionnel. Ironiquement, ces produits sont la plupart du temps plus transformés chimiquement que le bon vieux savon à froid.
La soude devient alors un épouvantail marketing, plutôt qu’un ingrédient accepté pour ce qu’il est réellement.
Saponification : disparition totale, transformation totale
Lorsqu’un savon à froid est bien formulé, il ne reste plus aucune trace de soude dans le produit fini. Tous les ions hydroxyde (OH⁻) réagissent avec les acides gras des huiles pour former :
- des sels d’acides gras = le savon et
- de la glycérine naturelle, très hydratante.
Cette réaction est irréversible et auto-limitée : la soude est neutralisée et stabilisée. Aucun risque d’agression pour la peau, à condition de :
- respecter les bons calculs (calculateur de soude),
- bien peser les ingrédients,
- laisser au savon le temps de sa cure (4 à 6 semaines).
C’est cette précision artisanale qui distingue le bon savonnier (vos serviteurs) du bricoleur du dimanche.
Vers une pédagogie de la chimie artisanale
Comprendre la fonction de la soude, c’est mieux faire ses choix en tant que fabricant, mais aussi en tant que consommateur. Cela permet :
- de reconnaître un savon de qualité,
- de ne pas céder à la peur des mots techniques,
- d’expliquer au public que chimie ne veut pas dire danger, surtout lorsqu’elle est maîtrisée.
La chimie n’est pas l’ennemi du naturel. C’est son interprète rigoureux. Dans le cas du savon, elle est même sa seule voie de création.
Une molécule à réhabiliter
Comme vous l’aurez compris, la soude mérite mieux que sa mauvaise réputation.
Oui, elle est puissante. Oui, elle est corrosive.
Mais bien utilisée, elle est inoffensive, invisible dans le savon fini — et même fondatrice.
La prochaine fois que vous tenez un savon doux entre vos mains, souvenez-vous que c’est entre autres grâce à la soude qu’il a pu naître.
Et cette naissance est un bel exemple de ce que la chimie artisanale peut faire de plus simple, de plus élégant, de plus… propre.